QUI sont-ils ? Épisode 8
Épisode 8. Ils ont donné leur nom à une avenue, une rue, un théâtre ou une place de notre territoire ou d'ailleurs. Des noms qui nous sont devenus familiers au fil du temps, mais dont nous ignorons tout ou presque. Partons à la découverte de ces hommes et femmes au parcours souvent hors du commun.
 François Cabarrus
François Cabarrus
Une voie à Bayonne, près du Conservatoire, lui rend hommage. Né à Bayonne en 1752 et mort à Séville en 1810, François Cabarrus fut un financier et économiste franco-espagnol d’envergure. Issu d’une famille de négociants et de marins basques, il grandit dans un environnement polyglotte, maîtrisant le français, le basque et l’espagnol. Après des études en France, il s’installe en Espagne, où il épouse Maria Antonia de Galabert y Casanova en 1772. Conseiller du Roi Charles III, il fonde la Banque San Carlos, première banque centrale espagnole, et introduit le papier- monnaie en Espagne. Anobli par Charles IV, il est accusé de détournement de fonds et emprisonné pendant deux ans. Sous l’occupation française de l’Espagne, Joseph Bonaparte le nomme ministre des Finances en 1808, poste qu’il conserve jusqu’à sa mort. Homme des Lumières, « Francisco Cabarrús » se distingue par sa volonté de réformer la société et son immense capacité de travail, ce qui lui vaut une place parmi les figures illustres de l’Espagne du XVIIIe siècle. Sa fille, Thérésa Cabarrus, joue un rôle crucial pendant la Révolution française, notamment dans la chute de Robespierre, gagnant le surnom de « Notre-Dame de Thermidor ».
Léon Bérard
Une rue à Sauveterre-de-Béarn et une voie à Pau ont été baptisées ainsi, de même que le Collège de Saint-Palais jusqu’en 2014. Avocat et homme politique français né à Sauveterre-de-Béarn en 1876, Léon Bérard a marqué la IIIe République. Après des études de droit à Paris, il débute sa carrière comme secrétaire de Raymond Poincaré et avocat des compagnies d’assurances.
Il devient maire de sa ville natale en 1904 puis député des Basses-Pyrénées six ans plus tard. Ministre de l’Instruction publique de 1919 à 1924, il réforme l’enseignement secondaire en réintroduisant le latin obligatoire dès la sixième. Sénateur pendant une décennie, il occupe plusieurs fonctions, dont garde des Sceaux et président du Conseil général des Basses-Pyrénées.
Élu à l’Académie française en 1934, il soutient les intellectuels persécutés par le nazisme. Ambassadeur du régime de Vichy auprès du Vatican (1940-1944), il négocie les relations avec Franco et informe sur les positions du Saint-Siège face au nazisme. Après la Libération, inéligible, il se consacre à la littérature et publie dans La Revue des deux Mondes. Opposé à l’espéranto, il défend l’influence internationale de la langue française. Homme cultivé et prudent, il incarne une politique conservatrice teintée de pragmatisme.
 Mademoiselle Montansier
Mademoiselle Montansier
Le Théâtre de Versailles, situé au coeur du quartier Notre-Dame et à quelques pas du Château de Versailles et de l’Opéra royal, porte son nom. Marguerite Brunet, dite Mademoiselle Montansier, fut une comédienne et directrice de théâtre française emblématique. Née à Bayonne en 1730, elle débuta comme apprentie à Paris, adoptant le nom de sa tante, Madame Montansier. Après un séjour en Martinique, elle rentra en France où elle gravit les échelons sociaux grâce à ses relations influentes. En 1774, elle devient « Directrice des Spectacles à la suite de la Cour », obtenant le privilège de Louis XVI d’organiser les événements de Versailles et d’autres villes royales. Elle inaugura son premier théâtre à Versailles en 1777. Pendant la Révolution, elle dirigea le Théâtre des Beaujolais à Paris, qui deviendra le Théâtre Montansier, puis les Variétés, tout en suivant les troupes françaises en Belgique où elle prit la tête du Théâtre de la Monnaie. Arrêtée sous la Terreur, elle fut libérée après dix mois et poursuivit sa carrière. Sous Napoléon, elle transféra les Variétés au boulevard Montmartre en 1807, assurant son succès. Infatigable et visionnaire, elle dirigea plusieurs salles majeures, contribuant durablement à la scène française. Elle s’éteint en 1820 à Paris, laissant une empreinte unique dans l’histoire du théâtre. Une comédie créée en 1904, « La Montansier », honore sa mémoire.
Didier Daurat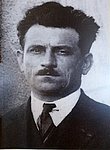
Une allée à Anglet, une rue paloise et de nombreuses en France portent son nom. Né à Montreuil-sous-Bois en 1891, Didier Daurat est une figure emblématique de l’aviation française et un pionnier de l’Aéropostale. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, où il s’est distingué comme pilote et a été décoré de la Légion d’honneur, il rejoint en 1919 les Lignes Aériennes Latécoère. Il devient directeur d’exploitation en 1920, établissant une réputation de chef rigoureux et exigeant. Daurat est connu pour sa méthode unique de formation des pilotes, les initiant d’abord à la maintenance des avions. Cette approche, cruciale pour l’autonomie dans des conditions difficiles, a permis à l’Aéropostale de garantir une fiabilité sans précédent sur des lignes reliant Toulouse au Sénégal ou au Chili. Visionnaire, il détecte et développe des talents, comme Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz. Quand l’Aéropostale est intégrée à Air France en 1933, il est écarté et fonde Air Bleu en 1935, assurant des services postaux performants. Durant la Seconde Guerre mondiale, il contribue au maintien des liaisons aériennes postales en zone libre. Après la guerre, il relance la Postale de nuit avant de rejoindre Air France jusqu’à sa retraite en 1953. Décédé en 1969, il est enterré à sa demande sur l’aérodrome de Toulouse Montaudran, ancienne base de l’Aéropostale. À sa destruction, il est inhumé à Marseille dans le caveau familial.

